




Le projet « Les Dynamiques – Faire avec la société civile » a l’ambition de (re)placer une société civile au centre du débat et de la décision publique.

Le projet « Les Dynamiques – Faire avec la société civile » a l’ambition de (re)placer une société civile au centre du débat et de la décision publique. Pilier déterminant de la démocratisation, la société civile est par sa puissance et sa diversité l’expression la plus large de l’intérêt général.
Acteur local tout autant que global, la société civile a aussi un rôle à jouer dans les affaires du monde. Et cela est particulièrement vrai pour ce qui est des relatons entre l’Europe et l’Afrique, l’Afrique et l’Europe. Ces deux continents, voisins et frères, séparés par la mer Méditerranée devront à l’avenir faire face à des défis communs. Le futur des populations africaines et européennes est lié et leur collaboration future inévitable. La définition de cet avenir commun implique la participation pleine et au même niveau des sociétés civiles constituées sur chaque rive de la Mer commune.
C’est en partenariat avec Le Monde Afrique que Res Publica a décidé de développer le projet "Les Dynamiques".

La société civile, qu’elle soit organisée ou non, présente une puissance considérable dans les sociétés modernes. Par son nombre, tout d’abord, car elle est constituée - potentiellement - de l’ensemble de la population d’un territoire ou d’un espace. Par sa diversité, ensuite, car elle est à même de recouvrir une grande variété de points de vue en direction d’un objectif commun. Par son effet levier, enfin, car elle est bien souvent à l’origine de changements sociaux, de transitons sociales.
Bien que potentiellement puissante, la société civile achoppe souvent, trop souvent, à prendre les rênes de son destin. Si elle parvient à initier des transitons, à « faire bouger des lignes », elle est écartée de l’exercice du pouvoir par le personnel politique. Ce constat vaut, à des degrés divers, pour les sociétés européennes et africaines. Dans les deux ensembles, la société politique s’est imposée sur la société civile.


Si la société politique affirme qu’elle exerce son action dans l’intérêt général, la réalité offre un paysage différent. A l’examen, l’action politique exercée sur les deux continents est affectée par trois limites qui en réduisent l’envergure et érodent la place de la société civile et par conséquent celle de l’intérêt général :
La première limite concerne l’enfermement de l’action politique dans le court terme.
La décision et le jeu des échéances électorales préemptent le quotidien des décideurs, les inscrivent dans le « court-termisme » et leur ôtent toute vision stratégique de leur action.
La deuxième limite concerne la définition des termes du débat public, voire la limitation de ce débat, par la société politique. Les débats relatifs à des domaines jugés sensibles par la société politique, tels que la sécurité ou encore l’immigration, sont « cadenassés » et ne permettent pas une discussion ouverte et argumentée laissant de fait la société civile « sans voix » ou reléguant son action au domaine de la contestation ou de la manifestation.
La troisième limite concerne la tendance des décideurs politiques à exercer une maîtrise sans partage du pouvoir et de son exercice. Cette tendance existe, voire se renforce, dans bien des régions du monde, en Afrique comme en Europe. Or, la maîtrise du pouvoir ralentit, quand il n’empêche pas, les processus de transformation des sociétés.
Absence de vision politique, orientation du débat politique et tendance à la maîtrise du pouvoir sont les maux dont souffrent les sociétés contemporaines accaparées par l’omniprésence de la société politique. Il est temps de réparer ce déséquilibre et de (re)donner à la société civile la plénitude de son action et de sa place. Il est temps de « faire avec la société civile ».


L’objectif des rencontres organisées dans le cadre du projet Les Dynamiques est de réunir des acteurs africains et européens pour établir un processus de réflexions et de discussions sur la place et le rôle des organisations de la société civile africaines et européennes dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques tant au niveau international, national que local. Les rencontres de la société civile doivent permettre de :
• poser les bases d’une analyse de la nature et des caractéristiques de la société civile africaine et européenne. Cela comprend une analyse sur l’identité, la vision, les valeurs, les composantes, les enjeux et défis, les forces et faiblesses, les différences et divergences etc. de la société civile en Afrique et en Europe ;
• définir un cadre de discussions et de partenariat pour promouvoir et améliorer les relations entre les organisations de la société civile africaine et européenne;
• proposer des recommandations et des plans d’action en vue d’améliorer la participation des organisations de la société civile à la conception, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques.
Prochainement, nous constituerons un comité d’accompagnement composé d’acteurs africains et européens pour établir un processus de réflexion et de discussion sur la place et le rôle des organisations de la société civile africaines et européennes dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques tant au niveau international, national que local.


Mi-mai, « Le Monde Afrique » a organisé, en partenariat avec Les Dynamiques quatre web-débats pour donner un écho aux idées, aux projets que portent penseurs, artistes ou militants du continent. Les quatre discussions qui se sont tenues via des web-débats du 5 au 8 mai s’inscrivent dans cette lignée. Ces temps forts ont permis d’aborder des thèmes centraux et de dessiner les contours d’une Afrique capable de rebondir. Une Afrique, déjà prête à rebondir dans l’après-coronavirus et à écrire « le jour d’après ».
Sans une bonne santé, pas d’économie pérenne. C’est ce que la crise mondiale du nouveau coronavirus vient de rappeler brutalement aux Etats du monde entier. L’Afrique, bien que peu touchée par la pandémie avec ses 75 530 cas déclarés et 2 559 décès au 15 mai, ne fait pas exception. Si le quatuor d’invités du premier web-débat organisé par Le Monde Afrique, mardi 5 mai, s’est accordé sur ce point, tous ont abondé sur les chemins à suivre pour permettre d’offrir aux 1,2 milliard d’Africains le bien-être et les soins qu’ils attendent.
« La santé est une question cruciale, au carrefour de tous les secteurs économiques », a insisté le docteur Seydou Coulibaly, économiste, chargé pour l’Afrique de l’Ouest des questions de financement et de couverture sanitaire universelle au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais, attention, si les Etats n’y travaillent pas, le privé veille. En embuscade pour se saisir de marchés prometteurs quand la classe moyenne africaine s’élargira.
Même s’il n’endosse pas officiellement ce rôle, l’artiste est le premier architecte de l’Afrique de demain, celui qui pense le continent plus loin. Certains agissent dans l’urgence palliant la faiblesse, voire l’incurie, des politiques publiques africaines, comme Mahi Binebine, peintre, romancier et sculpteur de renommée internationale, qui a mis son talent et son argent, avec Nabil Ayouch, le réalisateur de Much Loved sélectionné à Cannes en 2015, au service des gamins des bidonvilles du Maroc.
D’autres travaillent à transformer directement les lieux de vie pour faire société autrement. Une approche que développe l’Ivoirien Issa Diabaté, architecte et urbaniste, diplômé de Yale, aux Etats-Unis. « L’architecture et l’urbanisme ont toujours été des outils de transformation de la société. Des outils politiques et géographiques », explique-t-il exemple à l’appui.
Avec la violence de la crise économique qui menace le continent, il est plus que jamais urgent de se poser la question du « comment ». Comment changer la société pour en faire un espace plus social, plus juste, plus durable ? Faut-il dénoncer ou faut-il agir ? Faut-il combattre hors du champ politique ou descendre dans l’arène ?
Quatre personnalités militantes africaines aux parcours singuliers ont répondu à ces questions. La Tchadienne Hindou Oumarou Ibrahim, le Camerounais Valsero ou l’Ivoirien Antoine Assalé Tiemoko sont tous passés par le creuset de la société civile, « grosse école de formation des citoyens », pour le rappeur Valsero. Mais ensuite, leurs chemins et leurs stratégies ont différé…
L’épreuve du Covid-19 l’a montré : Internet est un allié et un ennemi. Un levier pour la prévention et un moyen de surveiller les populations… « Même en exigeant le consentement des citoyens pour que leurs données personnelles puissent être utilisées, le danger est évidemment de traquer les individus en traquant le virus », soutenait lors du web-débat Gildas Guiella, créateur de WakatLab, premier fab-lab africain en 2011 basé à Ouagadougou.
Si le pire n’est jamais loin, Moustapha Cissé, professeur d’intelligence artificielle (IA) à l’Institut africain de sciences qui a créé avec Facebook et Google en 2017 le premier master d’IA du continent, voulait aussi voir que « le meilleur » arrive aujourd’hui sur le continent via la tech. Le mathématicien veut croire à une technologie « qui soit alignée sur les valeurs que chaque société considère comme les meilleures ».
Cette série d'interview a été réalisée par le Monde Afrique en partenariat avec l’association Res Publica dans le cadre du projet " Les Dynamiques."
Dans son nouveau livre, l’ex-champion du monde de football décrypte le contexte dans lequel les sociétés européennes ont inventé des catégories raciales.
Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux (1er/12/2020)
Noirs et Blancs, la mémoire dans la peau (2/3). Lilian Thuram a pour habitude de dire qu’il est « devenu noir à l’âge de 9 ans » quand on le lui a signifié à son arrivée en métropole, lui qui avait grandi jusque-là en Guadeloupe. De la même manière, avance-t-il dans La Pensée blanche (éd. Philippe Rey), l’« on ne naît pas blanc, on le devient ». Au fond, tout ne serait que question de perspective et de regard.
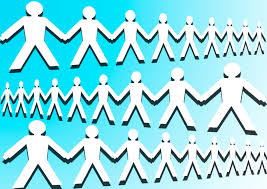
Dans cet ouvrage didactique très documenté, l’ancien champion du monde de football démontre en s’appuyant sur de nombreux exemples comment, en créant la figure du Noir dans le contexte esclavagiste et colonial, les sociétés européennes ont inventé, par voie de conséquence, celle du Blanc. Idéologie politique qui a divisé l’humanité pour mieux en exploiter une partie, la pensée blanche a ainsi forgé des catégories sociales qui continuent d’opérer dans les représentations et les imaginaires actuels et sont toujours projetées sur les individus, qu’ils soient fraîchement arrivés du continent africain ou français de peau noire depuis des générations. Sans chercher à culpabiliser, Lilian Thuram nous invite à questionner et à déconstruire cet héritage pour lutter efficacement contre le racisme et bâtir un monde en commun.
Vous partez d’un constat simple : on parle facilement de Noirs mais très difficilement de Blancs. Comme si blanc n’était pas une couleur. Comment l’expliquer ?
Lilian Thuram Dans mon livre, je relate cette histoire : j’ai demandé à un ami d’enfance, blanc de quelle couleur j’étais. Il m’a répondu « noir ». C’était une évidence. Je lui ai demandé ensuite de quelle couleur il était, lui. Il m’a répondu : « Je suis normal. » Il n’y a rien de méchant dans ce qu’il m’a dit, mais cela montre à quel point il a été éduqué à se penser comme étant la norme. Or la normalité ne se questionne jamais. En France, la question raciale est vue comme lointaine : soit elle concerne un passé reculé, soit elle est liée à l’apartheid en Afrique du Sud ou à la ségrégation aux Etats-Unis, comme si, au fond, l’Europe n’avait rien à voir avec le racisme.
Qu’est-ce qu’on appelle le « privilège blanc » ?
Oui. Quand de très nombreuses personnes sont discriminées pour leur couleur de peau, ne pas l’être relève du privilège. Pour ne pas avoir conscience qu’il y a un privilège blanc, il faut être blanc et ne s’être jamais posé la question. Ceux qui n’acceptent pas cette idée comparent souvent le quotidien d’un Blanc pauvre à celui d’un Noir riche pour dire qu’il n’y a pas de privilège blanc. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le privilège blanc est un privilège existentiel, celui de n’être jamais discriminé du fait de sa couleur. On ne se rend pas compte de la violence que c’est que de l’être.
Qui est blanc ?
Etre blanc, comme être noir, n’est pas une réalité, mais une perception : c’est à la fois être désigné comme tel et affirmer qu’on l’est. Aux Etats-Unis, il existait sous la ségrégation le phénomène du passing. Déménageant dans le Nord, des Noirs à la peau claire se faisaient passer pour blancs et devenaient blancs avec les privilèges qui vont avec.
Qu’est-ce alors que la « pensée blanche » ?
C’est cette construction idéologique qui invente le Blanc et les non-Blancs. La pensée blanche est née d’une volonté politique et économique. Elle divise les êtres humains en les classifiant à travers une supposée couleur de peau, et les hiérarchise avec une prétendue race blanche supérieure.
En affirmant qu’il y a une pensée blanche, en lieu et place d’une pensée raciste, n’y a-t-il pas un risque ?
Ce serait le cas si l’on parlait de la pensée des Blancs et non de la pensée blanche. Mais la pensée blanche n’est pas la pensée des Blancs. C’est une pensée qui est devenue une norme mondiale et qui peut aussi être celle de non-Blancs qui estiment qu’être blanc, c’est mieux. En Afrique, par exemple, l’on retrouve cette idée au sein de la société, y compris parmi les élites. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, dans cette frange de la population que cette idée est la plus diffusée. Il n’est pas rare que l’on dise à un enfant qui réussit quelque chose de bien « Toi, tu es un vrai Blanc ! ». En fait, il est très difficile d’échapper au modèle dominant et à la norme qu’il impose. On peut observer le même phénomène aux Antilles.
Y a-t-il une condition blanche en France ?
Oui, c’est une évidence, de la même manière qu’il y a une condition noire ou une condition féminine. La condition blanche repose sur un héritage historique que nous devons avoir le courage d’aborder, sans chercher à culpabiliser qui que ce soit. Il faut bien comprendre qu’aborder la question de l’égalité des Blancs et des Noirs ne se fera pas contre les Blancs mais profitera, au contraire, à tout le monde. Manifester contre les violences policières comme cela a été le cas en France après la mort de George Floyd n’est pas une action communautariste, comme cela a pu être dit. C’est un combat pour tous, pour le vivre-ensemble. Il n’y a rien de plus républicain que de demander à l’Etat sa protection et son aide pour que les choses changent positivement.
Vous dites que l’on peut être raciste sans le vouloir ni même le savoir. Comment lutter contre le racisme dans ces conditions ?
Il y a une hypersensibilité sur cette thématique qui nous empêche d’avancer. Il faut accepter de se remettre en question. Et il est important de connaître l’histoire pour savoir ce qui nous a conditionnés.
En France, jusqu’en 1950, on apprenait dans les écoles que la race blanche était la race supérieure dans un manuel scolaire qui a été réédité jusqu’en 1977. Comment échapper à cela dans ce contexte ?
Cette pensée blanche, dites-vous, est née du système capitaliste. Comment lutter contre le racisme sans en sortir ?
C’est une question très importante. Tous les systèmes politiques liés à la racialisation ont été forgés par une élite intellectuelle, financière et politique. Le système esclavagiste n’a pas été élaboré par les paysans français, ni la colonisation par les ouvriers. La ségrégation ou l’apartheid n’ont pas été mis en place par les Blancs les plus pauvres. Le racisme est l’expression d’une volonté politique. La pensée blanche est liée au monde du capital et des profits, qui a besoin de diviser pour mieux régner. Lutter contre ce système nécessite de reconstruire des solidarités au moyen de politiques qui prennent soin des plus démunis, qui redistribuent les richesses de la manière la plus intelligente possible. Cela suppose une convergence des luttes. Nous devons faire le lien avec le sexisme, le racisme lié à la couleur de peau ou à la religion, l’homophobie. A chaque fois, ce sont les mêmes mécanismes qui opèrent.
Quelle est aujourd’hui la responsabilité des Blancs par rapport à cette histoire ?
Personne ne demande aux Blancs de se sentir coupables, mais ils doivent écouter et entendre les victimes de racisme. Apprendre l’histoire du racisme et, surtout, comprendre qu’on ne peut pas être neutre. Lorsque vous dites que vous ne voyez pas la couleur des gens, c’est d’une brutalité inouïe. Cela veut dire que vous ne voyez pas que certaines personnes sont violentées dans la société.
Quand des artistes ou des chercheurs blancs s’emparent de ces problématiques et dénoncent le racisme, ils sont parfois accusés d’appropriation culturelle ou de présenter une vision partiale. Comment faire alors ?
Ce sont des reproches que je ne saisis pas vraiment parce que, selon moi, l’on doit tous travailler pour l’égalité. Ce n’est pas parce que vous êtes noir que vous allez comprendre le mécanisme du racisme. Ni parce que vous êtes blanc. Vous allez le comprendre parce que vous aurez travaillé sur le sujet. Ce qui est dénoncé derrière cette question d’appropriation culturelle, c’est l’invisibilisation des personnes non blanches qui travaillent sur ces sujets. Peu importe la couleur de peau, le genre, il faut travailler sur cette question et confronter les différentes idées pour avancer.
La Pensée blanche, de Lilian Thuram, éd. Philippe Rey, 320 p., 20 euros.
Cette série a été réalisée en partenariat avec l’association Res Publica dans le cadre du projet Les Dynamiques.

Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux(30/11/2020)
Noirs et Blancs, la mémoire dans la peau (1). Spécialiste des migrations, le politologue s’attaque aux idées reçues sur l’immigration et pointe les résistances de la France à se voir comme un pays multiculturel.
Avec patience et humour, François Gemenne déconstruit les préjugés sur la question migratoire dans son dernier ouvrage, On a tous un ami noir (éd. Fayard). Chiffres à l’appui, le chercheur sur le climat et les migrations à l’université de Liège montre que non, ce n’est pas « toute la misère du monde » qui vient en Europe, mais plutôt des personnes issues des classes moyennes, davantage diplômées et qui aspirent plus à l’entreprenariat que les Français. Et non, les migrants ne coûtent pas cher au système social français, pas plus qu’il n’y a de « déferlante migratoire ».
Le politologue belge montre, par ailleurs, comment les politiques actuelles de l’accueil révèlent à quel point la France ne parvient pas à se penser pleinement comme une société multiculturelle et peine à intégrer à son identité les personnes non blanches.
*Le titre de votre ouvrage, On a tous un ami noir, renvoie à cette phrase utilisée pour se dédouaner de tout racisme et laisse entendre que l’on peut être raciste sans s’en rendre compte…
François Gemenne Absolument. Il est très important, pour lutter contre les discriminations, de pouvoir reconnaître la part de racisme qu’il y a en chacun de nous dans la manière dont nous regardons ceux qui sont différents de nous. Moi, qui suis blanc, je dois savoir que je jouis à ce titre d’un certain nombre de privilèges. Je ne me suis pas soucié, par exemple, de faire renouveler ma carte d’identité périmée parce que je sais que je ne me fais pas contrôler par la police. Il est certain que si j’avais eu une autre couleur de peau, j’aurais fait très attention à avoir des papiers en règle.
Vous parlez de « privilège blanc ». Selon vous, ses défenseurs et ses contempteurs ne parlent pas de la même chose.
Oui. Ceux qui nient l’existence d’un privilège blanc, ou les tenants de la gauche universaliste, parlent d’un idéal d’égalité, où la loi ne ferait aucune différence entre les citoyens. Ceux qui reconnaissent l’existence d’un privilège blanc, ou les tenants de la gauche intersectionnelle, parlent eux d’une réalité qui empêche justement cet idéal de se réaliser. Les universalistes disent qu’il n’y a qu’un seul type de citoyen français, pas de Blancs, de Noirs ou d’Arabes. Mais n’importe qui a déjà parlé à un agent immobilier, à un recruteur ou à un videur de boîte de nuit sait parfaitement que, dans la réalité, il en va autrement. En fait, reconnaître cette différence de traitement est nécessaire à la réalisation de l’idéal universaliste.
Vous expliquez que la frontière enferme les étrangers dans une altérité radicale comme si on ne parvenait pas à voir en l’autre quelqu’un qui nous ressemble. Est-ce là un échec de cet universalisme français ?
D’une certaine manière, oui. Car cet universalisme français ne se conçoit qu’à l’intérieur des frontières nationales et considère qu’il n’y a qu’un seul type de citoyen français, qu’il a tendance à opposer aux autres. Paradoxalement, l’universalisme français a perdu sa dimension universelle et cosmopolite. Il ne considère plus tous les humains comme étant égaux. Seuls sont égaux ceux qui sont du bon côté de la frontière, uniquement du fait de cette situation.
Est-ce ce qui explique que la confusion entre immigré et étranger soit entretenue en particulier pour les immigrés postcoloniaux ?
Oui, la France a du mal à penser son identité comme celle d’un pays multiculturel, et non plus en fonction d’un modèle de citoyen blanc. Elle doit renouveler ses représentations publiques et son imaginaire collectif pour intégrer ces immigrés à son identité. Les expressions d’« immigrés de deuxième » ou de « troisième génération » sont un non-sens. Etre immigré est un statut individuel et non une identité. On ne le transmet pas à ses enfants. Je suis Belge mais, parce que je suis blanc, on ne me considère jamais comme un étranger en France. Or nombre d’enfants d’immigrés ou de citoyens français en provenance des DOM-TOM sont souvent considérés comme des étrangers en raison de leur couleur de peau ou de leur religion.
Cela tient, dites-vous, au modèle de l’Etat-nation qui ne serait plus adapté…
L’Etat-nation est né au XVIIe siècle avec le traité de Westphalie, qui repose sur l’idée selon laquelle aux frontières géographiques du territoire correspondent les frontières démographiques de la population et à ces dernières les frontières politiques de la souveraineté.
Or les migrations font voler cela en éclats, car on a à la fois plusieurs populations mélangées sur un même territoire et une même population dispersée sur plusieurs territoires. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de Français s’expatrient. Très attachée à cette idée d’Etat-nation, la France a longtemps défendu un modèle assimilationniste pour l’intégration. D’où la difficulté à se reconnaître désormais comme une nation multiculturelle, qui n’est plus seulement catholique et blanche.
Que penser de l’évolution du vocabulaire utilisé pour parler des migrations ? On a d’abord parlé d’émigrés, puis d’immigrés et enfin aujourd’hui de migrants…
Les termes liés à la migration sont de plus en plus péjoratifs. Jadis, les migrants étaient vus comme des pionniers, des aventuriers. Aujourd’hui, ils sont plutôt perçus comme une menace. Parler de migrants suppose qu’ils sont toujours en déplacement, comme s’ils ne faisaient que passer et n’avaient pas vocation à s’installer. Du coup, on considère qu’il n’est pas nécessaire de développer des politiques d’accueil adaptées.
Or les politiques d’immigration et d’asile actuelles pour ceux qui viennent de l’autre côté de la Méditerrannée – et donc les institutions qui les gèrent – sont déshumanisantes et fondamentalement racistes en ce qu’elles considèrent ces étrangers comme étant inférieurs. Elles ont intégré l’idée de hiérarchisation raciale. Mais, dans une démocratie, nous sommes tous comptables des actions et des politiques décidées par nos gouvernements, même si nous n’avons pas voté pour eux. Nous devons reconnaître qu’il y a un racisme structurel et institutionnel.
Racisme structurel qui s’exprime aussi au sein de la police française ?
Les actes de racisme ou de violence policière sont traités comme des cas isolés. Mais en analysant les statistiques, on voit bien qu’il y a un nombre important de cas individuels, à tel point qu’on arrive à quelque chose de structurel qui s’installe au sein de la police. Cela ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes, mais que la manière dont l’institution traite la question témoigne du racisme institutionnel. Parce que la police est dépositaire de l’autorité publique et parce que vous ne choisissez pas les agents auxquels vous avez à faire, il y a une exigence d’irréprochabilité totale.
Faut-il des statistiques ethniques pour mesurer ce racisme ?
On ne peut lutter efficacement contre des discriminations que si on a un moyen de les objectiver pour les mesurer. Il y a aujourd’hui en France tout un tas de raisons, notamment liées à l’universalisme évoqué précédemment, qui empêchent de réaliser ces statistiques ethniques. Il y a aussi la crainte de l’instrumentalisation de ces statistiques ethniques par l’extrême droite, mais j’ai tendance à penser que c’est une terrible défaite de s’interdire d’avoir des instruments adaptés qui permettraient de mieux connaître les discriminations par crainte de l’usage que pourrait en faire l’extrême droite.
On a tous un ami noir, de François Gemenne, éd. Fayard, 256 p., 17 euros.
Cette série a été réalisée en partenariat avec l’association Res Publica dans le cadre du projet Les Dynamiques.